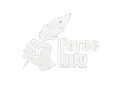Dans une tribune publiée ce lundi 22 septembre 2025, Maître Didace Mituato, ancien candidat gouverneur de la Tshopo lors des élections d’avril 2024, a dressé un constat amère sur la gouvernance actuelle de la plus vaste province du pays.
Pour lui, la province de la Tshopo, joyau potentiel au cœur de la République Démocratique du Congo, se trouve aujourd’hui à un carrefour décisif, oscillant entre un péril grandissant et un potentiel inexploité. Les signaux d’alarme s’accumulent, peignant le tableau d’une région où l’ordre institutionnel semble vaciller, et où les attentes légitimes de la population se heurtent à une réalité quotidienne de plus en plus difficile.
Un diagnostic sans complaisance : le rouge dominant les indicateurs
Il n’est plus possible d’ignorer les symptômes d’un mal profond qui ronge la province. Tous les indicateurs socio-économiques et sécuritaires sont passés au rouge vif, témoignant d’une paralysie progressive des services essentiels et d’une dégradation du tissu social. La sécurité, pilier fondamental de toute société prospère, est devenue une denrée rare. Les vols, qu’ils soient à petite échelle ou organisés, se multiplient avec une audace déconcertante, semant la peur et l’insécurité au sein de la population. Cette criminalité galopante érode la confiance des citoyens envers les institutions censées les protéger.
Parallèlement, le réseau routier, véritable colonne vertébrale du développement, est dans un état de délabrement avancé. Les routes urbaines de Kisangani, autrefois symboles de dynamisme, sont aujourd’hui des parcours du combattant, transformant les courtes distances en de véritables odyssées. Au-delà des centres urbains, les routes d’intérêt provincial, voies de communication vitales pour les échanges commerciaux et l’accès aux services de base, sont devenues synonymes de calvaire pour les usagers, isolant des territoires entiers et freinant toute initiative de développement local. Cette impraticabilité généralisée entrave la circulation des biens et des personnes, asphyxiant l’économie locale et accentuant la précarité. Face à un tel tableau, le constat est sans appel : la province de la Tshopo est en danger, et son avenir semble suspendu à un fil.

La sécurité : Entre responsabilité collective et défaillance institutionnelle
Il est de bon ton de rappeler que la sécurité est l’affaire de tous. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans la préservation de l’ordre public. Cependant, cette maxime ne saurait dédouaner les autorités établies de leur responsabilité première : celle de concevoir, de mettre en œuvre et de faire respecter des politiques publiques efficaces en matière de sécurité. Malheureusement, à l’état actuel des choses, un vide sidéral semble prévaloir au niveau provincial dans ce secteur crucial.
Pourtant, la province n’est pas démunie d’outils. Depuis 2021, des résolutions concrètes et pertinentes ont été formulées lors des états généraux de la sécurité, offrant une feuille de route claire pour adresser ces défis. Mais ces résolutions semblent être restées lettre morte, reléguées aux oubliettes des bonnes intentions. Il est grand temps d’opérer un changement radical d’approche. Cela passe par une responsabilisation effective de chaque service intervenant dans le secteur de la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette responsabilisation doit s’accompagner d’une dotation en moyens adéquats qu’il s’agisse de ressources humaines qualifiées, d’équipements modernes ou de formations continues afin de permettre à ces services de remplir pleinement leur mission et de mettre tous les malfrats hors d’état de nuire, restaurant ainsi un climat de confiance et de sérénité.
La question des infrastructures routières : un problème de gestion plus que de ressources
Le problème de l’état déplorable des infrastructures routières de la Tshopo n’est pas, comme on pourrait le croire, une question de manque de moyens. Le véritable nœud du problème réside dans la gestion, ou plutôt la non-gestion orthodoxe des ressources financières propres à la province. Des sources concordantes, souvent bien informées, révèlent que la province de la Tshopo mobilise une somme non négligeable d’environ 1.000.000 $ par mois.
Avec un tel budget mensuel, une gestion saine et transparente permettrait d’envisager des projets d’envergure. Il serait tout à fait envisageable de relier efficacement tous les territoires à Kisangani, la capitale provinciale, créant ainsi un maillage routier essentiel au désenclavement et au développement. Pour mettre cette somme en perspective, il est bon de savoir que l’enveloppe salariale provinciale est estimée à environ 300.000 $. Cela signifie qu’une part significative des ressources reste disponible pour des investissements structurants, si tant est qu’une volonté politique forte et une gestion rigoureuse soient mises en place. Le potentiel est là, les fonds aussi ; ce qui fait défaut, c’est une vision stratégique et une exécution implacable.
L’impératif de gouverner : prévoir, agir, et restaurer l’espoir
De tout ce qui précède, une conclusion s’impose avec force et clarté : la province de la Tshopo n’est pas condamnée à son sort actuel. À court terme, elle dispose des atouts et des ressources nécessaires pour trouver des solutions idoines et pérennes aux défis majeurs qui la paralysent, qu’il s’agisse de la sécurité des personnes et de leurs biens ou de la réhabilitation de ses infrastructures routières vitales.
L’adage populaire “Gouverner, c’est prévoir” résonne ici avec une acuité particulière. Il ne s’agit plus de constater l’échec, mais de s’engager résolument dans une voie de redressement. Cela implique une gouvernance proactive, transparente et orientée vers les résultats. Il est impératif que les autorités provinciales se saisissent de cette opportunité pour mettre en œuvre des actions concrètes, pour restaurer la confiance de la population et pour tracer un chemin vers un avenir où la Tshopo pourra enfin réaliser son plein potentiel, au bénéfice de tous ses habitants. L’heure n’est plus aux atermoiements, mais à l’action décisive.
Rédaction